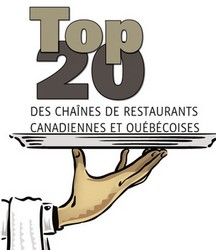La grippe A (H1N1) avait fait 27 victimes au Québec au moment d’écrire ces lignes, en octobre 2009. Faut-il s’alarmer ?
« En fait, la grippe que nous attendons au cours de l’automne se compare à la grippe saisonnière habituelle et ne présente pas de risques plus élevés, sauf qu’elle se propage plus aisément », explique Sylvain Lacombe, répondant ministériel au ministère du Tourisme pour tout ce qui concerne la pandémie.
Les travailleurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, qui sont en contact avec le public, courent-ils plus de risques que les autres d’attraper la maladie ?
« C’est la proximité qui peut avoir un impact, dit M. Lacombe. Le risque est plus grand pour un travailleur en contact avec le public que pour d’autres, certes, mais les gens de Montréal qui prennent le métro aux heures de pointe ont le même problème. »
Pour mettre les choses en perspective, M. Lacombe mentionne que la grippe saisonnière fait de 1200 à 1500 victimes en moyenne chaque année au Québec.
« Ces statistiques sont cependant gonflées par le fait que si une victime souffrait d’un autre problème de santé et qu’elle décède au moment où elle avait la grippe, cette dernière est considérée comme un élément aggravant ayant contribué au décès », dit-il.
Le même constat s’applique aux victimes de la grippe A (H1N1). « Sur les 27 décès rapportés, 24 des victimes souffraient d’une maladie sous-jacente », ajoute M. Lacombe.
Selon lui, il n’y a pas lieu de paniquer, mais le message essentiel à toute la population et aux entreprises est que nous devons revenir aux principales mesures d’hygiène, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter la propagation du virus.
Avoir un plan
Bien que pour le moment la grippe A (H1N1) ne soit pas considérée comme plus dangereuse que la grippe saisonnière par les autorités, cela ne signifie pas pour autant que l’on doive rester les bras croisés. Sans s’alarmer, il faut se préparer.
En tant qu’entrepreneurs, les restaurateurs, hôteliers et responsables de services alimentaires devraient toujours avoir un plan d’urgence, non seulement pour répondre à une pandémie, mais à tout cas de force majeure.
Or, un sondage publié en octobre dernier par BMO Banque de Montréal démontrait que 82 % des entreprises n’ont aucun plan général pour faire face à un éventuel problème sanitaire. Et les propriétaires de microentreprises (moins de cinq employés) sont les moins bien préparés.
Selon Victor Pellegrino, vice-président, service aux entreprises pour la BMO, un plan d’urgence doit inclure un plan de communication et une analyse des risques potentiels auxquels l’entreprise fait face.
Dans le cas des hôtels, restaurants et institutions, les risques sont multiples. Le risque le plus probable en cas de pandémie est celui de manquer de personnel. En milieu de travail, la propagation serait la même que dans la population en général, soit 35 % qui pourrait tomber malade, selon le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE).
Vos employés pourraient aussi s’absenter pour prendre soin d’une personne de leur famille infectée, ou parce qu’ils auraient peur d’attraper le virus. D’après la Loi sur la santé et la sécurité du travail, un employé a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que cela pose un danger pour sa santé. Il ne faut pas non plus oublier que cette même loi vous oblige, comme employeur, à prendre les mesures nécessaires pour protéger adéquatement vos employés.
En cas de pandémie grave, les employeurs peuvent s’attendre à un taux d’absentéisme pouvant atteindre 50 % au cours des semaines de pointe de la propagation, selon le MDEIE. Pouvez-vous vous permettre de vous priver de la moitié de votre personnel ?
De plus, selon le ministère, les secteurs comme l’hébergement et la restauration pourraient être particulièrement frappés en cas de pandémie, car les consommateurs réduiraient leurs dépenses en sorties et en loisirs. Avez-vous les moyens d’être privé de votre clientèle pendant plusieurs semaines ? Disposez-vous de liquidités ou d’une marge de crédit pour assurer la survie de votre entreprise en cas de chute de ses revenus ?
D’autre part, des services comme les transports, les communications et l’approvisionnement, nécessaires à la poursuite de vos activités, pourraient être réduits. On le voit, plusieurs risques doivent donc être pris en compte pour assurer la continuité de vos services en cas de crise. Que faire ?
« Il faut d’abord prévoir un plan de communications et définir les responsabilités de chacun en cas d’urgence, dit Victor Pellegrino. Cela commence par une chaîne d’appels. Si une crise se présente, on détermine qui doit lancer la chaîne et chaque personne est responsable d’appeler la suivante pour transmettre les consignes. » Il faut aussi se livrer à une analyse des risques potentiels, prévoir différents scénarios et trouver des solutions de rechange possibles, ajoute-t-il.
Sept questions et réponses sur la grippe A (H1N1)
- Quels sont les symptômes de la grippe A (H1N1) ?|
Ils sont semblables à ceux de la grippe saisonnière : toux, fatigue, diminution de l’appétit et douleurs musculaires. Certaines personnes infectées présentent de l’écoulement nasal, des maux de gorge, des nausées et de la diarrhée.
- Comment peut-elle être transmise ?|
Le virus se transmet à partir des gouttelettes du nez et de la bouche de la personne infectée. On peut l’attraper en entrant en contact avec une surface contaminée ou avec une personne infectée à l’occasion de contacts rapprochés si l’on touche ensuite à son nez, à sa bouche ou à ses yeux. On peut donc l’attraper des personnes que l’on côtoie, en soignant quelqu’un, en utilisant les transports en commun et en participant à des rassemblements.
- Que faire si l’on présente des symptômes ?
Les personnes infectées devraient rester chez elles et se reposer jusqu’à la fin des symptômes et limiter l’entourage. Les médicaments en vente libre peuvent être utilisés pour soulager les symptômes.
- Combien de temps les personnes infectées sont-elles contagieuses ?|
Une personne infectée peut être contagieuse 24 heures avant l’apparition des symptômes et jusqu’à 7 jours après leur début.
- Devrait-on recommander à nos employés de porter un masque pour se protéger ?|
Jusqu’à maintenant, les autorités gouvernementales ne recommandent pas de porter un masque pour se protéger de la grippe A (H1N1). Cette mesure n’a pas été jugée efficace pour éviter la transmission de la grippe. Les gens portent souvent leur masque de manière inadéquate ou le contaminent en l’installant ou en le mettant, ce qui augmente les risques de contamination. Seules les personnes malades devraient porter un masque quand elles se trouvent avec d’autres personnes.
- Peut-elle être transmise par la nourriture, notamment par la viande de porc, auquel le virus a d’abord été associé ?|
Le virus ne survit pas à la cuisson et vit difficilement dans un lieu chaud. Pour l’instant, aucune contre-indication pour la nourriture n’a été émise par les autorités. Les mesures s’appliquant aux personnes qui manipulent la nourriture sont les mesures d’hygiène générales (voir encadré Prévention).
- Le virus peut-il survivre sur des surfaces comme les planchers ?|
Le virus survit mieux dans des endroits frais et secs. Il peut survivre de 48 à 72 heures sur les surfaces dures comme les planchers, les poignées de porte, la vaisselle ou une rampe d’escalier, mais il peut être détruit facilement si on nettoie ces surfaces avec des désinfectants ménagers, comme l’eau de javel. De plus, il faut savoir que le virus survit pendant 5 minutes sur les mains, et de 8 à 12 heures sur du tissu, du papier ou des mouchoirs de papier.
Source : Pandémie Québec
Des outils pour vous aider
Le gouvernement du Québec met à votre disposition des guides pour vous préparer et vous informer en cas de pandémie de grippe. Ces guides sont tous disponibles sur le site Pandémie Québec.
- Mesures de prévention dans un contexte de pandémie d’influenza à l’intention des employeurs et travailleurs du Québec
- Aide-mémoire sur les normes du travail à considérer en cas de pandémie
- Guide à l’intention des entreprises pour la planification de la continuité des opérations en cas de pandémie d’influenza, MDEIE
Source : Pandémie Québec
Prévention et mesures d’hygiène
Favoriser l’hygiène des mains et l’hygiène respiratoire des employés en s’assurant qu’ils ont reçu l’information nécessaire.
Consignes à donner :
- Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir de papier lorsque l’on tousse ou que l’on éternue et jeter le mouchoir à la poubelle.
- En l’absence de mouchoir de papier, tousser ou éternuer dans le pli du coude ou le haut du bras.
- Se laver les mains souvent avec de l’eau et du savon. Si l’on n’a pas accès à l’eau et au savon, utiliser un produit antiseptique.
- S’assurer que les travailleurs et les clients disposent du nécessaire pour l’hygiène des mains et l’hygiène respiratoire : mouchoirs de papier, savon, rince-main antiseptique à séchage rapide à base d’alcool (minimum 60 % d’alcool).
- Limiter l’accès sur les lieux de travail des personnes présentant des symptômes de grippe en affichant des avis aux points d’accès des entreprises.
- Pour éviter la contamination, favoriser la distance entre les personnes. Réduire les réunions, et dans les lieux de rassemblement, respecter dans la mesure du possible une distance d’un mètre entre les personnes.
- Déterminer une politique de présence au travail pour les personnes présentant des symptômes. Autant que possible, ces personnes ne doivent pas se présenter au travail et si c’est inévitable, elles doivent porter un masque et rester à l’écart des autres.
- Nettoyer toutes les aires communes (planchers, poignées de porte, boutons de commande des appareils, accessoires de cuisine, installations sanitaires, postes de travail) avec de l’eau chaude, du savon et du détergent domestique.
- Désinfecter les surfaces avec une partie d’eau de javel pour 50 parties d’eau au minimum une fois par jour. Les surfaces de contact avec la clientèle doivent être nettoyées plus souvent.
Source : Mesures de prévention dans un contexte d’épidémie d’influenza à l’intention des employeurs et travailleurs du Québec, Organisation de la sécurité civile du Québec.
Des pistes pour vous préparer- Élaborez un plan de communication d’urgence
- Nommez un coordonnateur ou établissez une équipe d’intervention en cas de pandémie
- Donnez à vos employés des directives claires sur les mesures d’hygiène et de prévention
- Considérez les mesures à prendre en cas d’absences (changements d’horaires, d’heures d’ouverture, heures supplémentaires, remplacements, embauches, etc.)
- Encouragez vos employés à se faire vacciner contre l’influenza
Source : MDEIE