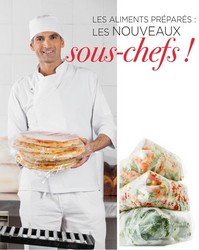LES TENDANCES MARCHÉ : CONSOLIDATION ET EXPANSION
STAGNANT POUR LES GROS, JOUABLE POUR LES MICROS
Au Canada, le marché de la bière est un marché stable dont la croissance actuelle oscille entre 0 et -1,5 % par année. Ce sont les microbrasseries (soit les brasseries à petit volume) qui enregistrent les taux de croissance les plus intéressants grâce notamment à la consommation sur place dans les broue pubs (bars de microbrasseries). Aux États-Unis, les brasseries artisanales visent à décrocher 20 % des parts de marché d’ici 2020 (le fameux twenty-twenty). Y parviendront-elles ?
QUAND LES GROS ACHÈTENT LES PETITS
« L’acquisition de microbrasseries nous permet d’acquérir de nouvelles marques, d’avoir des produits plus "nichés". N’oublions pas que plus de 84 % des achats de bière au Québec sont encore de type lager comme les Budweiser (1 bière sur 5) », explique Jean Gagnon, vice-président des affaires corporatives pour Labatt Québec. Même chose du côté du géant Molson Coors, qui a créé une division chargée de la commercialisation des bières de microbrasserie (par son entreprise Six Pintes). Les mégas qui rachètent des micros, c’est donc aussi et surtout une façon d’occuper tous les interstices du marché, d’ajouter une offre complémentaire à un portefeuille de produits déjà vaste. En contrepartie, ces rachats donnent aux produits de brasseries régionales un accès aux réseaux de distribution des plus grandes brasseries.
À LA CONQUÊTE DES MARCHÉS EUROPÉENS
Les brasseries américaines percent peu à peu les marchés européens, zone de grande tradition et de consommation brassicoles (Allemagne, République tchèque, Grande- Bretagne, Belgique). Par exemple, Stone Brewing Co., dixième brasseur artisanal en importance aux États-Unis, ouvre bientôt un complexe de production (afin de garantir la fraîcheur de ses produits) ainsi qu’un restaurant haut de gamme à Berlin. Au Québec, les exportations de bières artisanales vers l’Europe sont encore timides, car la province brassicole reste pour le moment encore méconnue en dehors des frontières canadiennes ou américaines.
LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION
Investissement ou renouvellement complet de l’équipement de même qu’agrandissement ou déménagement d’installations de fabrication et d’entreposage dans des espaces beaucoup plus grands s’observent tant du côté des gros brasseurs que des petits. Des petits qui se rapprochent aussi des bassins de population plus importants, à savoir en ville, par l’ouverture de succursales.
LE SEGMENT DES BIÈRES IMPORTÉES CROÎT AU SEIN DU HRI
En restauration, les bières importées comme les Stella Artois, Corona, Leffe et Hoegaarden représentent 13 % du volume de bière consommé au Québec. Ces marques importées occupent de plus en plus le marché en développant notamment leur service de verrerie, un rituel qui procure de la valeur ajoutée aux restaurateurs. Pour Hugues Gagnon, copropriétaire de la brasserie Benelux, les établissements qui tiennent de 30 à 40 lignes de bières — dont certaines importées d’Europe — devraient se préoccuper de la fraîcheur des produits plutôt que de vouloir absolument proposer un vaste choix. Pour lui, il y a forcément des winners et des losers parmi toute cette offre !
Palette de dégustation du Benelux
« Nous commençons à exporter en Europe. Là-bas, la popularité des bières locales est en train de changer. Depuis deux ou trois ans, une légère ouverture d’esprit s’opère — par exemple, en Belgique et en Angleterre. »
— Alain Thibault, sommelier en bière, Brasseurs du Monde (Saint-Hyacinthe)
MICROBRASSERIES* AU QUÉBEC
- 31 en 2002
- Environ 140 en 2015
- Prévision pour 2020 : 218
- Part de marché (tablettes, bars et restaurants) : 8,7 %
- Nombre de producteurs artisanaux** (vente sur place seulement) : 51
- Nombre de producteurs industriels** : 87
*Aucune définition légale. Pour l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ), une microbrasserie est un brasseur dont la production ne dépasse pas 300 000 hectolitres/an. Au Québec, la majorité des microbrasseries ne dépassent pas 5 000 hectolitres/an.
**Au Québec, deux types de permis de brasseur existent : artisanal ou industriel. Ce permis n’a aucun lien avec le volume de bière produit (par exemple, Molson et Dieu Du Ciel ! ont les mêmes permis), mais il est relié aux conditions de vente et de distribution des produits.
Après l’Elixir, la Mauvaise influence et la Frankenstein, Brasseurs du Monde lance une nouvelle bière extra-forte : 25º. Avec son taux d’alcool de 25 %, cette liqueur de malt extra-forte de la Gamme Spiritueux s’annonce comme la bière la plus forte à être embouteillée au Canada ! Prochainement sur le marché.
Le secteur brassicole est entré dans une phase d’expansion. Ces derniers temps, beaucoup de dollars ont été investis pour renouveler ou moderniser les équipements, comme à la Brasserie et coopérative de travail La Barberie.
Photo : © Émilie Dumais
LES TENDANCES PRODUITS : QUALITÉ ET DIVERSITÉ
Les microbrasseurs essaient et expérimentent. C’est l’une des signatures du Québec brassicole actuel : réunir toutes les interprétations brassicoles sur une même carte, mélanger les genres et les influences, qu’elles soient américaines ou européennes. Petite tournée des tendances bière…
- CANETTE De plus en plus de petits brasseurs proposent leurs produits les plus populaires en canette afin de répondre aux besoins de leur clientèle « sorteuse » (camping, fêtes extérieures, etc.).
- FERMIÈRE (Farmhouse) La bière fermière s’apparente à la bière de saison (du temps où les fermes brassaient leurs propres bières). C’est une tendance continuellement à la hausse depuis environ trois ans. Ces bières sont souvent fermentées avec un mélange de levures, dont au moins une « brett » (levure sauvage).
- FUNKY Dans cette vaste catégorie, on retrouve des bières issues de techniques de brassage ou de fermentation non traditionnelles, aux arômes originaux : les bières sures ou surettes (comme les Lambic, Gueuze, Berliner Weisse, Gose, Lichtenhainer) et les bières aux levures sauvages (les brettanomyces dites « brett »), à la fois sèches et rafraîchissantes.
- INDIA PALE ALE (IPA) Même si ce type de bières atteint le haut de la croissance, tout le monde continue d’en faire en proposant diverses variantes (des microstyles, sorte de bières fusion), comme les Black IPA. La vague de popularité du houblon, venue des États-Unis, a fait exploser la culture de cette plante, aujourd’hui très en demande (lire notre encadré).
- SAISON Aux fruits, herbes, plantes, épices d’ici et d’ailleurs. Aussi des bières du terroir québécois, comme les bières amérindiennes de la microbrasserie Le Naufrageur.
- SANS GLUTEN La demande et l’offre sont assez stables dans cette catégorie de bières vraiment à part qui demande un équipement spécifique, généralement plus coûteux. Au Québec, le chef de file est la microbrasserie Glutenberg.
- SESSION La demande pour ces bières faibles en alcool (entre 2,5 % et 4 %) mais très goûteuses a été forte à l’été 2015. Celles de type « session » houblonnées devraient encore dominer.
- SIGNATURE Dans le monde de la bière artisanale, la collaboration de deux brasseurs en vue de créer une nouvelle recette est une pratique courante. La collaboration brasseur-chef est plus rare, sauf s’il y a un chef « dans la place » comme Éric Blackburn, chef corporatif à la microbrasserie La Voie Maltée (lire notre encadré). La brasserie Dieu du Ciel ! et le restaurant montréalais Toqué ! se sont récemment associés pour lancer une bière à l’argousier, la Brise-vent ! La microbrasserie Glutenberg et le sommelier François Chartier ont aussi collaboré pour la gamme Série Gastronomie.
- VIEILLIES EN BARRIQUE (de brandy, cognac, whisky, mezcal, vin, etc.) Apparue sur le marché en 2010, cette tendance qui flirte avec le monde des spiritueux et du vin (bières vinicoles) reste toutefois encore limitée sur le plan des volumes produits. La raison ? Ces bières exigent du temps avant d’être commercialisées, de l’espace de stockage, et les barriques ne sont pas faciles à trouver… Ce sont des bières d’occasion qui se bonifient avec l’apport gustatif conféré par les essences de bois des barils choisis et des alcools ayant séjourné dedans.
La vague houblon
Devant la mode des bières houblonnées de type IPA lancée par les brasseurs américains, le houblon est devenu une culture très en demande. Les prix se sont envolés au moment de la crise de 2008, lorsque l’Ouest américain — important fournisseur — a connu une sécheresse entraînant une pénurie de la matière première sur le marché. Depuis, les prix se sont stabilisés, mais les brasseurs passent désormais leur commande longtemps à l’avance auprès de leurs fournisseurs. Celles de 2019 sont déjà bouclées (le cycle de culture du houblon étant de trois ans). Vu l’engouement pour ces plantes grimpantes, certains producteurs québécois se lancent dans la culture. Jusqu’à ce qu’un jour ils puissent fournir les brasseurs régionaux en houblon québécois.
Microbrasserie La Barberie
Photo : © Émilie Dumais
« Au rythme où ça va, je pense qu’il n’y a pas de styles qui périclitent. À un moment donné, il y a eu une forte demande pour les bières fortes. Elle l’est moins aujourd’hui, mais elle est toujours là. Même chose pour les bières sures et les IPA. Elles sont encore là. Je pense qu’il n’y a rien qui est out. »
— Benoit Mercier, copropriétaire de la brasserie Benelux
ÉRIC BLACKBURN, CHEF CORPORATIF À LA MICROBRASSERIE LA VOIE MALTÉE
« La cuisine à la bière va bien au-delà de l’utilisation du produit fini pour des sauces ou des mijotés. Moût réduit en sirop très concentré, drêche séchée et utilisée en chapelure ou pour une pâte à pizza, malt déshydraté et réduit en poudre, vinaigre de bière, huile de houblon… J’en ai encore pour des années avant de faire un tour complet des produits issus des différentes étapes de brassage ! Les microbrasseries démocratisent le "mieux boire". Moi, je veux démocratiser le "mieux manger" avec la bière ! J’aspire à réveiller le marché, à lancer une tendance, un mouvement. Car la bière peut rejoindre la haute gastronomie… avec une cravate desserrée ! Aux États-Unis, par exemple à Chicago, la cuisine à la bière est bien exploitée, et beaucoup de livres de recettes sont publiés sur le sujet. Nous devrions voir naître prochainement au Québec des gastropubs misant sur une transformation de la bière poussée à son maximum. »
LES TENDANCES CLIENTS : CONNAISSANCE ET SERVICE
LES BIÉROPHILES, LES BEER GEEKS, LES AMATEURS DE BIÈRES Avides de savoir, de comprendre, de découvrir, ils suivent de près les actualités du milieu brassicole et les tendances en cours. Comme les classements de produits et de brasseries (par exemple sur le site Ratebeer.com), les commentaires ou retours de dégustation se sont extrêmement multipliés, certains brasseurs artisanaux y ont un peu perdu l’intérêt. Sauf s’ils sont mentionnés en haut d’un classement !
LE TOURISME DE BIÈRES En pleine croissance, il prend diverses formes : visites de micromusées (ou centres d’interprétation), participation à des visites guidées ou des circuits touristiques en région, fréquentation de festivals brassicoles...
LA BIÈRE ET LA CUISINE « La surprise ? La cuisine, on la voyait comme secondaire. » C’est ce que l’on peut entendre dans le long métrage documentaire Brasseurs de Pierre-Luc Laganière, qui brosse un portrait du milieu brassicole québécois. La demande étant et aidant, l’offre de nourriture s’est développée au sein des brasseries artisanales, qui se sont lancées en restauration. On privilégie le plus souvent des formules petits plats (p. ex. : hot dogs, poutines et pizzas) pour accompagner les produits offerts, mais on trouve aussi des propositions plus gastronomiques (gastropub), souvent à base de produits du terroir.
LA BIÈRE À TABLE L’importance du service (bonne température, verre adéquat, accord mets-bière) et les conseils de sommellerie en bière pour la mise en place de cartes comme celles qui existent pour le vin se développent. De fait, les formations de sommellerie en bière sont en croissance ici et ailleurs. Quant au métier de brasseur, il s’organise lui aussi : MaBrasserie, une coopérative de solidarité brassicole dont le siège social se trouve à Montréal, est en train de s’affilier à l’Institut Brassicole du Québec (lui-même affilié à l’École de technologie supérieure) pour développer un volet éducatif. « Je me rends fréquemment chez mes clients de la restauration. Ce sont des bars et des restaurants qui veulent des conseils pour structurer leur carte. Je fais goûter les produits de la brasserie, j’explique les différences, les accords possibles… comme pour le vin. La bière regagne sa place dans les cartes des restaurants. On en revient à ce qui était autrefois, lorsqu’elle était consommée à table au même titre que le vin. Elle perd son image populaire ; elle devient plus chic », raconte Alain Thibault, sommelier en bière aux Brasseurs du Monde, à Saint-Hyacinthe.
« Dans les grandes villes comme Toronto ou Vancouver, les bons restaurants ont une carte de bières, ce qui n’est pas encore le cas au Québec. Mais cela change tranquillement. Une conception de la bière vraiment pensée "bouffe" (de la part des restaurateurs) devrait venir. »
— Jean-François Gravel, cofondateur de la brasserie Dieu du Ciel !
Photo en tête d’article : © Katya Konioukhova